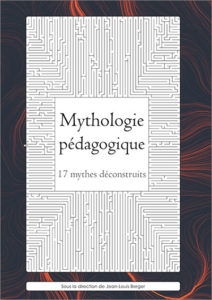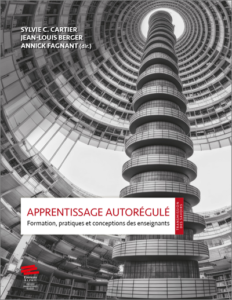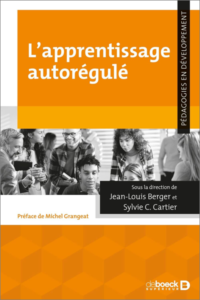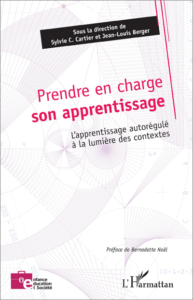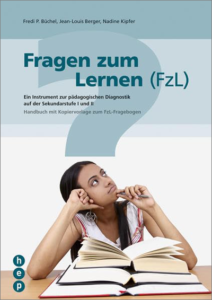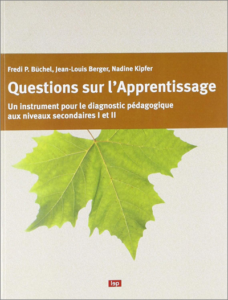Auteure : Angélique Odin
1. Introduction
Dans le domaine de l’éducation, le principe d’apprentissage autorégulé est un concept large mais essentiel pour les apprenant∙e∙s. Il peut être défini comme l’ensemble des mises en œuvre de pratiques réfléchies vers des objectifs d’apprentissage spécifiques. Cela inclut la planification, la réflexion, la mise en œuvre, le monitorage et le contrôle, tous poursuivis avant, pendant et après l’apprentissage (Berger & Cartier, 2023). En d’autres termes, l’apprentissage autorégulé fait référence à la manière dont les apprenant∙e∙s s’organisent à atteindre leurs objectifs d’apprentissage tout en maintenant leurs efforts cognitifs, motivationnels et comportementaux pour arriver à ces buts (Schunk & Greene, 2018). Ces propos laissent croire que l’apprentissage autorégulé est uniquement dépendant des caractéristiques individuelles de l’apprenant∙e, tels ses intérêts et ses motivations. Cependant, comme l’indique le modèle de Zimmermann, basé sur les travaux de Bandura, deux autres facteurs sont impliqués dans cette autorégulation : le comportement de l’apprenant∙e et son environnement (Usher & Schunk, 2018). Par ces notions, Zimmermann souligne l’importance de l’interaction entre ces trois éléments, indissociables l’un de l’autre. L’apprenant∙e peut influencer son comportement et son environnement par un mise en place de stratégies d’apprentissage plus ou moins efficace. En retour, le comportement et l’environnement fournissent des feedbacks qui peuvent renforcer le sentiment d’efficacité personnelle de l’apprenant∙e (Cosnefroy, 2010). Ce cycle de rétroaction met en évidence l’importance du cadre d’apprentissage.
De nombreuses recherches ont démontré que les apprenant∙e∙s qui maîtrisent l’autorégulation d’apprentissage utilisent des stratégies cognitives plus efficaces, s’engagent davantage dans des activités plus ardues et montrent une plus grande persévérance dans le temps consacré aux études. De ce fait, l’apprentissage autorégulé devient non seulement un atout majeur pour la réussite scolaire, mais aussi pour l’apprentissage autonome au-delà du cadre éducatif formel.
Dans le cadre de ce travail, l’autorégulation de l’apprentissage sera évaluée à l’aide de deux outils de mesure. L’objectif principal est d’analyser si les étudiant∙e∙s d’écoles supérieures présentent des scores élevés en termes d’autorégulation, ce qui indiquerait une mise en œuvre efficace de stratégies d’apprentissage. En plus de cette évaluation, une autre visée de ce travail est de comparer les résultats obtenus avec deux tests spécifiques, à savoir le SRLIS (Self-Regulated Learning Inventory System) et le SKT-SRL (Strategy Knowledge test for self-regulated learning). Ceux deux outils sont conçus pour mesurer des aspects similaires, mais il est pertinent de s’interroger sur leur degré de concordance.
2. SRLIS
Description de l’outil
Le Self-Regulated Learning Interview Schedule (SRLIS), traduit en français par le protocole d’entretien sur l’apprentissage auto-régulé, est une mesure structurée de l’autorégulation de l’apprentissage, à travers lequel, les élèves décrivent verbalement leurs techniques d’apprentissage dans différents scénarios proposés (Song et al., 2011). L’objectif de cet outil est d’étudier le lien entre les stratégies d’apprentissage autorégulées et la capacité à acquérir des connaissances ou à développer ses compétences. Il a été conçu en 1986 par Zimmermann et Martinez-Pons, et est aujourd’hui utilisé dans diverses études sur les pratiques d’apprentissage (Nota et al., 2004).
Le développement initial de cet outil s’est fait avec des élèves de dixième année inscrit∙e∙s dans une école secondaire traditionnelle aux Etats-Unis. Le SRLIS vise à identifier quelles stratégies d’apprentissage sont principalement mobilisées par les élèves parmi 14 catégories prédéfinies. Ces stratégies incluent : l’auto-évaluation, l’organisation et la transformation, la fixation d’objectifs et la planification, la recherche d’informations, la tenue de registres et un suivi, une structuration de l’environnement, les conséquences personnelles, la mémorisation, la recherche d’aide sociale auprès de ses pair∙e∙s – des enseignant∙e∙s – des adultes, l’examen des dossiers entre les tests – les notes – les manuels, ou la catégorie autre indiquant un apprentissage initié par autrui.
A travers ce test, Zimmermann et Martinez-Mons ont mis en lumière que la fréquence d’utilisation des stratégies autorégulées est un prédicteur clé des résultats obtenus aux examens (Nota et al., 2004). Cette corrélation s’est avérée plus significative que le sexe ou le statut socio-économique, bien que ces derniers soient aussi des valeurs prédictives significatives (Nota et al., 2004). Les chercheur∙euse∙s ont ensuite étendu leur recherche à d’autres groupes d’apprenant∙e∙s, et ont constaté que les élèves surdoué∙e∙s utilisent plus fréquemment des stratégies d’organisation et de transformation du matériel pédagogique (Nota et al., 2004). Cependant, le SRLIS a été conçu à l’origine pour des élèves de niveau secondaire, dans des écoles traditionnelles (Song et al., 2011). Il n’a pas été spécifiquement conçu pour les étudiant∙e∙s de l’enseignement supérieur. Dès lors, il est intéressant de se demander quelles réponses ce test pourrait offrir dans un contexte universitaire, où les stratégies d’apprentissage peuvent être mobilisées différemment.
Description de l’échantillon
Cette étude porte sur deux étudiantes de l’Université de Fribourg, toutes deux inscrites en deuxième année de Master à la faculté des Sciences et de Médecine, dans le domaine des Sciences du Sport et du Mouvement. La première participante, âgée de 26 ans, se spécialise dans l’enseignement pour le secondaire II. À ce stade, bien qu’elle se destine à une carrière dans l’éducation, elle n’a pas encore suivi de cours à caractère pédagogique. La deuxième participante, âgée de 24 ans, poursuit également ses études dans le domaine de l’éducation physique et sportive pour le secondaire II, avec une branche complémentaire en mathématiques. A ce stade, elle n’a pas non plus suivi de formation pédagogique.
Ces deux étudiantes établissent des profils académiques relativement proches, portant une attention dirigée dans l’éducation au secondaire II. Seules les branches secondaires se distinguent avec une vocation en biologie pour le premier sujet et les mathématiques pour le second. Une relation étroite expliquée par les liens amicaux établis dans le cadre de nos études en sport.
Description de la méthodologie
Le SRLIS se déroule sous forme d’entretien structuré. Les chercheur∙euse∙s demandent aux participant∙e∙s quelles stratégies ils∙elles mettent en œuvre dans six contextes d’apprentissage différents. Dans la version originale de l’outil, le test se déroulait à la fois en classe ou en dehors de celle-ci (Giroux, 2012). Dans le cadre de ce travail, les entretiens sont enregistrés et se déroulent individuellement, c’est-à-dire qu’un seul sujet est interrogé à la fois. Cette approche permet de mieux traiter les réponses fournies oralement et d’en analyser les détails avec plus de précision. Lorsque les réponses ne correspondent à aucune des 14 catégories de stratégies d’apprentissage définies, les chercheur∙euse∙s redirigent les sujets afin d’obtenir des réponses claires et catégorisées. À partir des entretiens, les stratégies d’apprentissage mentionnées sont ensuite classées dans les 14 catégories prédéfinies de l’outil. L’accent est mis sur la fréquence d’utilisation de ces stratégies pour comprendre lesquelles sont les plus souvent mobilisées par les participant∙e∙s dans leur apprentissage autorégulé. Il est important de souligner qu’aucune catégorie de stratégies n’est considérée comme plus importante qu’une autre (Giroux, 2012). Ce travail de catégorisation vise à identifier la manière dont chaque apprenant∙e régule son apprentissage.
Présentation des résultats
La première participante à l’entretien s’est montrée très spontanée dans ses réponses. Bien que ses réponses aient été courtes, elles étaient très précises et allaient à l’essentiel. Grâce à ses retours, il a été facile de catégoriser ses stratégies, qui entraient toutes dans les 14 catégories prédéfinies par le test. Deux catégories principales se sont distinguées dans ses stratégies : la fixation d’objectifs et la planification, ainsi que la tenue de registrent et le suivi (cf. Tableau 1). Par ailleurs, la participante a confirmé, à l’aide d’une échelle de Likert (1 = jamais ; 2 = rarement ; 3 = souvent ; 4 = tout le temps), utilisée pour quantifier la régularité de l’utilisation des stratégies, que celles identifiées à deux reprises sont celles appliquées systématiquement, lors de chaque apprentissage. La tenue de registres et le suivi révèlent une démarche proactive d’enregistrement des informations reçues, qui se sont manifestées dans ce cadre de recherche par la prise de notes et une écoute active pendant les leçons. Quant à la fixation d’objectifs et à la planification, elles consistent en l’élaboration d’un calendrier des activités aboutissant aux objectifs d’apprentissage. Cette approche a été concrétisée par le sujet avec une mise en pratique immédiatement après chaque cours, afin de renforcer ses acquis sur des éléments récents en mémoire.
Tableau 1
Descriptif des catégories d’apprentissage mises en pratique par le sujet 1
| Scénarios | Stratégies | Échelle de Likert (1-4) |
| 1 | Tenue de registres et suivi | 4 |
| 2 | Fixation d’objectifs et planification | 4 |
| 3 | Fixation d’objectifs et planification | 4 |
| 4 | Tenue de registres et suivi | 4 |
| 5 | Conséquences personnelles | 2 |
| 6 | Structuration de l’environnement | 2 |
Note. Le tableau est une synthèse des résultats obtenus lors d’un entretien oral et structuré.
Le deuxième sujet ayant pris part à l’étude a également fait preuve de précision dans ses réponses, permettant ainsi de catégoriser chacune de ses stratégies. Une catégorie est ressortie à trois reprises : la fixation d’objectifs et la planification. D’ailleurs, durant l’entretien, le terme de planification a été prononcé de manière répétée : « je planifie un jour où j’ai du temps libre ». Une autre s’est distinguée deux fois : la tenue de registres et le suivi. La participante a confirmé utiliser la fixation d’objectifs et la planification pour chaque apprentissage, en attribuant une note de 4 sur l’échelle de Likert. Concernant la tenue de registres, elle a indiqué une utilisation fréquente, avec une note de 3. Quant à la structuration de l’environnement, mentionnée une seule fois, elle a précisé qu’elle utilise cette stratégie dans la plupart des cas, et ce d’une manière uniforme : « je m’assois dans un endroit agréable, comme un café, avec un casque atténuant les bruits externes, et je bois une boisson qui me fait plaisir ».
Tableau 2
Descriptif des catégories d’apprentissage mises en pratique par le sujet 2
| Scénarios | Stratégies | Échelle de Likert (1-4) |
| 1 | Tenue de registres et suivi | 3 |
| 2 | Fixation d’objectifs et planification | 4 |
| 3 | Fixation d’objectifs et planification | 4 |
| 4 | Tenue de registres et suivi | 3 |
| 5 | Fixation d’objectifs et planification | 4 |
| 6 | Structuration de l’environnement | 3 |
Note. Le tableau est une synthèse des résultats obtenus lors d’un entretien oral et structuré.
Discussion sur l’outil de mesure
Ces résultats laissent suggérer que le SRLIS catégorise les stratégies d’apprentissage de manière conforme. En effet, les types de stratégies définis par le test semblent correspondre aux pratiques réellement mises en place par l’apprenant∙e, comme l’indique l’échelle de Likert. Par ailleurs, d’autres études ont également évalué la validité de ce test. Notamment, l’étude de Zimmerman & Martinez-Pons (1988) a confirmé la validité des items grâce à une analyse en composantes principales, suivie d’une rotation factorielle oblique. Cette analyse repose sur la théorie selon laquelle il existe un facteur commun d’autorégulation de l’apprentissage chez les élèves. Cependant, cet outil reste un indicateur des stratégies d’apprentissage mises en pratique, sans fournir de retour sur leur efficacité pour l’apprenant∙e.
3. SKT-SRL
Description de l’outil
Le Strategy Knowledge Test for Self-Regulated Learning (SKT-SRL), traduit par test de connaissance des stratégies dans l’apprentissage autorégulé, est un outil qui mesure les connaissances en matière de stratégies d’apprentissage, en analysant des stratégies prédéterminées et appliquées à des scénarios imposés (Dörrenbächer-Ulrich et al., 2024). Destiné aux étudiant∙e∙s de l’enseignement supérieur, cet outil de mesure diagnostique les lacunes d’apprentissage dans le but de les combler par des interventions appropriées. En effet, bien que ce public démontre généralement de grandes connaissances, il demeure souvent limité en termes de stratégies d’apprentissage.
La conception de cet outil repose sur le modèle de processus de Zimmermann, un cadre largement connu avant la création de ce test et majoritairement utilisé dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (Dörrenbächer-Ulrich et al., 2024). En s’appuyant sur ce modèle, le SKT-SRL propose sept scénarios d’apprentissage couvrant différents domaines essentiels : la cognition, la métacognition et la motivation, tous nécessaires à l’apprentissage autorégulé. Ces domaines, liés à l’apprentissage autorégulé, sont examiné à travers des scénarios qui suivent les phases d’apprentissage : la planification, la performance et la réflexion.
A travers ces différents scénarios, six stratégies sont présentées, certaines étant évaluées comme inefficaces, et d’autres comme efficaces dans l’apprentissage. A savoir, ces stratégies ont été évaluées et validées par des expert∙e∙s de la psychologie et de l’éducation, garantissant leur pertinence. Ainsi le test fournit des scores indiquant les lacunes et les forces des étudiant∙e∙s.
Description de l’échantillon
Cette étude examine les mêmes sujets que l’outil présenté précédemment, permettant une analyse comparative directe entre ces deux instruments de mesure.
Description de la méthodologie
Le SKT-SRL se déroule sous forme d’entretien individuel structuré, de manière similaire au test précédent. Les encadrant∙e∙s du test présentent oralement les sept scénarios, un par un, et demandent aux participant∙e∙s d’évaluer chacune des six stratégies proposées pour chaque scénario en utilisant une échelle de Likert, de 1 à 4 (1=pas du tout utile ; 4=tout à fait utile) (Dörrenbächer-Ulrich et al., 2024). Une fois les appréciations récoltées, le calcul des scores peut être effectué.
Pour chaque scénario, trois stratégies sont évaluées comme étant plus utiles que les autres, jugées moins utiles. Sur cette base, les scores attribués aux stratégies plus utiles sont comparés aux scores des stratégies moins utiles, par soustraction. Par exemple, si une stratégie considérée comme utile par les expert∙e∙s reçoit une note de 4 de la part du∙de la participant∙e, cette valeur sera soustraite aux scores des trois stratégies jugées moins utiles par les expert∙e∙s. Cette opération est répétée pour les trois stratégies utiles dans chaque scénario, permettant un score maximal de 18 par scénario.
Il est important de respecter la pondération : la note maximale est de 2, même si la stratégie utile est notée 4 et celle moins utile sur 1, le score maximal reste plafonné à 2. De plus, la note minimale est de 0, afin d’éviter des valeurs négatives dans le test. Un exemple sera illustré dans la section suivante, lors de la présentation des résultats.
Présentation des résultats
Tableau 3
Résultat du test SKT-SRL pour sujet 1
| Scénarios | Scores |
| Planning – plan motivationnel | 12 |
| Planning – plan métacognitif | 18 |
| Performance – plan motivationnel | 9 |
| Performance – plan métacognitif | 16 |
| Performance – plan cognitif | 16 |
| Réflexion – plan motivationnel | 16 |
| Réflexion – plan métacognitif | 8 |
Note. Le score maximum par scénario est de 18. Le tableau indique un total de 95/126.
Le premier sujet montre des résultats globalement positifs. Avec un total de 95 sur 126, soit 75% des réponses en accord avec celles des expert∙e∙s, cette étudiante démontre une bonne connaissance des stratégies d’apprentissage autorégulé. Plus précisément, la participante obtient l’intégralité des points pour la planification d’un point de vue métacognitif, ce qui suggère une gestion efficace du temps de travail et des objectifs définis de manière concise et réalisable. Son score est également élevé sur le plan métacognitif et cognitif de la performance, illustrant une mise en pratique efficace dans son apprentissage, régulée en fonction de ses propres besoins. La motivation à entamer le travail se révèle également être un point fort.
Cependant, l’auto-évaluation de ses connaissances semble être négligée, tout comme l’auto-instruction faisant appel à des ressources supplémentaires.
Tableau 3
Résultat du test SKT-SRL pour sujet 2
| Scénarios | Scores |
| Planning – plan motivationnel | 3 |
| Planning – plan métacognitif | 18 |
| Performance – plan motivationnel | 11 |
| Performance – plan métacognitif | 12 |
| Performance – plan cognitif | 5 |
| Réflexion – plan motivationnel | 14 |
| Réflexion – plan métacognitif | 0 |
Note. Le score maximum par scénario est de 18. Le tableau indique un total de 63/126.
Avec un total de 63 sur 126, soit 50% de réponses en accord avec celles des expert∙e∙s, la deuxième participante montre une connaissance partielle des stratégies d’apprentissage autorégulé. Plus précisément, elle obtient l’intégralité des points pour la planification métacognitive, ce qui suggère une gestion efficace du temps de travail et des objectifs bien définis. Cependant, elle n’utilise aucune stratégie d’auto-évaluation jugée utile par les expert∙e∙s. Elle présente également des lacunes en matière de motivation pour débuter un travail, susciter de l’intérêt et élaborer des stratégies face aux tâches difficiles à accomplir.
Discussion sur l’outil de mesure
Les scores établis par le test permettent une interprétation claire grâce à des valeurs quantitatives. En effet, cette forme de résultats offre une lecture accessible, mettant en valeur les forces et les lacunes du sujet de manière simple et efficace.
Cependant, cette interprétation, bien que synthétique, tend à universaliser l’efficacité des stratégies, jugées utiles ou non-utiles par les expert∙e∙s, sans aucune prise en compte des caractéristiques individuelles du sujet. Or, les méthodes et stratégies d’apprentissage sont très distinctes d’une personne à l’autre. Comme le montre ce travail, les résultats des deux sujets divergent, alors que toutes deux sont en voie de réussite, dans un cursus similaire.
4. Comparaison des outils
Les outils présentés précédemment abordent une même thématique, à savoir les stratégies d’autorégulation de l’apprentissage. Cependant, leurs objectifs diffèrent. Le SRLIS vise à identifier les stratégies d’apprentissage mises en pratique par les sujets dans des scénarios imposés, tandis que le SKT-SRL évalue les connaissances des sujets sur ce même thème, afin de diagnostiquer leurs lacunes et de les combler par des interventions appropriées.
De ce fait, les visées de ces tests ne sont pas identiques, ce qui se reflète dans leurs résultats et leur interprétation. La comparaison établie dans ce travail visait à déterminer si les connaissances en stratégies d’apprentissage sont corrélées avec leur mise en pratique. Les résultats étant mitigés, soulignent les différences d’orientation et d’intention entre ces deux outils.
5. Conclusion
Étant donné les objectifs divergents des tests, les deux outils n’ont pas conduit aux mêmes conclusions. Les comparaisons intra-sujet ont montré des différences selon l’outil utilisé, mettant en évidence une absence de corrélation entre les stratégies utilisées et celles maîtrisées et connues par le sujet.
De même, les comparaisons inter-sujet n’ont pas non plus révélé de corrélation entre les résultats des différents individus, chaque sujet présentant des résultats distincts. Ce constat questionne l’outil SKT-SRL, qui tend à universaliser l’utilité des stratégies d’apprentissage autorégulé. Or, ce travail montre une divergence quant à son applicabilité, avec des sujets qui progressent tous avec succès dans leur cursus universitaire.
6. Bibliographie
- Berger, J. L., & Cartier, C. S. (2023). L’apprentissage autorégulé. De Boeck.
- Cosnefroy, L. (2010). L’apprentissage autorégulé : perspectives en formation d’adultes. Savoirs, 23(2), 9‑50. https://doi.org/10.3917/savo.023.0009
- Dörrenbächer-Ulrich, L., Sparfeldt, J. R., & Perels, F. (2024). Knowing how to learn: development and validation of the strategy knowledge test for self-regulated learning (SKT-SRL) for college students. Metacognition and Learning, 19(2), 1–45. https://doi.org/10.1007/s11409-024-09379-w
- Giroux, L. (2012). L’autorégulation de l’apprentissage comme levier à l’affiliation d’étudiants étrangers inscrits dans le système universitaire québécois [Thèse de doctorat, Université du Québec à Trois-Rivières]. https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/6858/1/030565188.pdf
- Nota, L., Soresi, S., & Zimmerman, B. J. (2004). Self-regulation and academic achievement and resilience: A longitudinal study. International Journal of Educational Research, 41(3), 198‑215. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2005.07.001
- Schunk, D. H., & Greene, J. A. (2018). Historical, Contemporary, and Future Perspectives on Self-Regulated Learning and Performance. In D. H. Schunk & J. A. Greene (Eds), Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance (pp. 1‑15). Routledge.
- Song, H. S., Kalet, A. L., & Plass, J. L. (2011). Assessing medical students’ self-regulation as aptitude in computer-based learning. Advances in Health Sciences Education, 16(1), 97‑107. https://doi.org/10.1007/s10459-010-9248-1
- Usher, E. L., & Schunk, D. H. (2018). Social Cognitive Theoretical Perspective of Self-Regulation. In D. H. Schunk & J. A. Greene (Eds), Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance (p. 19‑35). Routledge.
- Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1988). Construct Validation of a Strategy Model of Student Self-Regulated Learning. Journal of Educational Psychology, 80(3), 284‑290. https://doi.org/10.1037/0022-0663.80.3.284
SRLIS & SKT-SRL