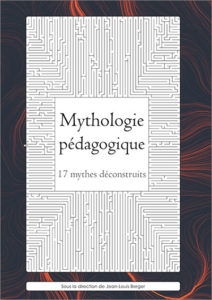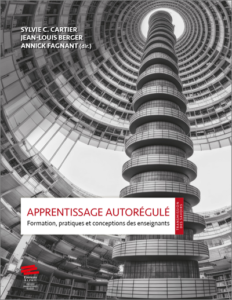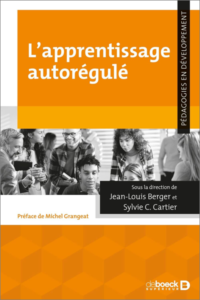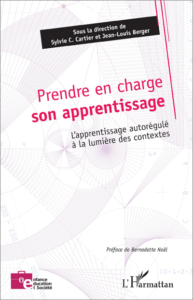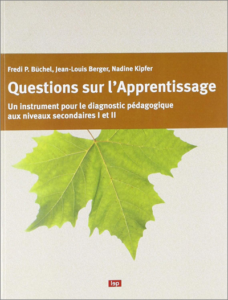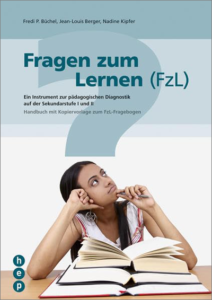Auteure: Dayana Kostova
1. Introduction
Ce travail aborde le thème de l’apprentissage autorégulé, en mettant l’accent sur les stratégies et les processus d’autorégulation de deux étudiantes universitaires. Avant de procéder à l’analyse, il est essentiel de définir les concepts clés.
La capacité d’apprendre est une compétence fondamentale pour le développement et l’adaptation de l’individu·e·s à l’environnement (Berger et Buchel, 2013). En ce sens, selon Boekaerts (1997) l’objectif principal de l’école doit être d’enseigner les compétences d’autorégulation, qui sont essentielles non seulement pour atteindre ses objectifs pendant la formation, mais aussi pour s’auto-éduquer et mettre à jour ses connaissances après la formation et dans la vie de tous les jours. Selon Schunk et Greene (2017), l’autorégulation se réfère à la manière dont les étudiant·e·s soutiennent et activent leur comportement, leur motivation et leur cognition afin d’atteindre leurs objectifs personnels. Par conséquent, les élèves qui autorégulent leur apprentissage sont ceux qui planifient, fixent des objectifs, organisent, contrôlent et évaluent eux-mêmes les différentes étapes de l’acquisition des connaissances (Zimmerman, 1990). En ce sens, selon une perspective sociocognitive, Zimmerman (2002) décrit l’autorégulation comme un processus cyclique qui peut être divisé en trois phases : la phase d’anticipation, qui comprend la planification stratégique et les croyances personnelles sur ses capacités ; la phase d’action, qui comprend les processus stratégiques et l’auto observation de l’apprentissage ; et la phase d’autoréflexion, qui comprend l’auto-jugement et l’auto-réaction concernant ses performances.
En ce sens, plusieurs outils ont été développés pour évaluer et étudier l’apprentissage autorégulé (Frenkel, 2014), tels que le Self-Regulated Learning Interview Schedule et le Thinking aloud.
2. SRLIS
2.1. Description de l’outil
Le Self-Regulated Learning Interview Schedule (SRLIS) est un instrument qui permet d’évaluer l’utilisation par les élèves de stratégies d’autorégulation en milieu scolaire et non scolaire (Zimmerman et Martinez-Pons, 1986). Le SRLIS prend la forme d’un court entretien directif dans lequel, pour chaque scénario d’apprentissage présenté, les étudiant·e·s sont invités à indiquer les méthodes et les stratégies utilisées pour étudier, participer en classe et préparer un travail (Zimmerman et Martinez-Pons, 1986). Sur la base d’études pilotes menées auprès d’élèves de lycée, Zimmerman et Martinez-Pons (1986) ont identifié six scénarios d’apprentissage dans différents contextes : à la maison, pendant l’exécution de tâches d’écriture en dehors de la classe, dans des situations de faible motivation et pendant la préparation d’un examen. En outre, les auteurs ont identifié 14 catégories de stratégies d’apprentissage autorégulé utiles pour classifier les stratégies d’autorégulation mentionnées par les élèves (cf. tableau 1.).
2.2. Description de l’échantillon
Pour ce travail, l’échantillon était composé de deux étudiantes de l’Université de Fribourg. La première participante (P1) a 24 ans et est en première année de Master en Psychologie clinique. La deuxième participante (P2) a 23 ans et est en deuxième année de Master en Sciences du Sport et Géographie. Les participantes ont été sélectionnées parce qu’elles ont montré de l’intérêt et de la curiosité pour le sujet et les entretiens proposés.
2.3. Description de la méthodologie
Pour chaque scénario d’apprentissage les participantes ont été invitées à mentionner les stratégies et les méthodes utilisées. Avant l’entretien, les participantes ont été informées de leur participation volontaire et de la possibilité de se retirer à tout moment sans aucune conséquence. En outre, la confidentialité de leurs réponses leur a été garantie.
Après avoir informé les participantes, l’entretien s’est déroulé dans un environnement calme et silencieux. Si les participantes mentionnaient une ou plusieurs stratégies, il leur était demandé d’évaluer la régularité avec laquelle elles les utilisaient sur une échelle de Likert 1 à 4 points (1=rarement ; 2= occasionnellement ; 3= fréquemment ; 4= la plupart du temps). En outre, si, au cours de l’entretien, les participantes rencontraient des difficultés à répondre, la question suivante leur était posée : « Et si vous rencontrez des difficultés ? Y a-t-il une méthode particulière que vous utilisez ? ». Les réponses ont été recueillies par enregistrement et sont présentées en annexe (cf. transcription 1 ; transcription 2 ; tableau 2a et tableau 3a.).
Une fois l’entretien terminé, les stratégies d’autorégulation utilisées par les participantes ont été identifiées grâce aux 14 catégories de stratégies définies par Zimmerman et Martinez- Pons (1986). En outre, dans un tableau récapitulatif, la présence ou l’absence d’une certaine stratégie a été indiquée au moyen d’un score dichotomique (0-1) (cf. tableau 2b et tableau 3b.).
L’interprétation des résultats a cherché à mettre en évidence la cohérence entre la régularité moyenne d’utilisation déclarée par les participantes lors de l’entretien et la fréquence des mentions d’une stratégie dans les différents scénarios d’apprentissage (cf. tableau 2c et tableau 3c.).
2.4. Présentation des résultats
2.4.1. Interprétation des résultats de P1
Les réponses de la première participante montrent l’utilisation de différentes stratégies d’autorégulation (cf. tableau 2a et tableau 2b).
Le tableau 2c montre la fréquence des différentes stratégies d’autorégulation dans les différents scénarios et la régularité moyenne d’utilisation déclarée lors de l’entretien pour chaque stratégie. Les stratégies les plus souvent mentionnées par la première participante sont trois, dont : « Organisation et transformation », « Recherche d’aide sociale » et « Auto- évaluation ». En ce qui concerne la stratégie « Organisation et transformation », elle est mentionnée quatre fois dans quatre scénarios différents. En moyenne, la participante utilise cette stratégie d’autorégulation la plupart du temps, résultat cohérent avec ses déclarations dans tous les scénarios. De plus, il est intéressant de noter que dans trois scénarios sur quatre, la participante mentionne toujours la même stratégie de réorganisation du matériel pédagogique. En ce qui concerne la stratégie de « Recherche d’aide sociale », en particulier l’aide reçue des pairs, la participante a mentionné cette stratégie quatre fois dans trois scénarios différents. En moyenne, la participante a demandé fréquemment de l’aide à ses pairs, un résultat cohérent avec ce qui a été déclaré dans les trois scénarios. Enfin, la stratégie « Auto-évaluation » est mentionnée trois fois dans trois scénarios différents. En moyenne, la participante utilise fréquemment cette stratégie, un résultat cohérent dans les scénarios un et six mais dans le scénario quatre la participante déclare qu’elle auto-évalue son apprentissage la plupart du temps.
En ce qui concerne les autres stratégies qui n’ont pas souvent mentionnées, la participante a déclaré qu’elle changeait souvent l’environnement d’étude pour faciliter son apprentissage et sa motivation à étudier. Cependant, la stratégie « Structuration de l’environnement » n’a été mentionnée qu’une seule fois dans un scénario.
2.4.2. Interprétation des résultats de P2
Les réponses de la deuxième participante montrent l’utilisation de différentes stratégies d’autorégulation (cf. tableau 3a et tableau 3b).
Le tableau 3c montre la fréquence des différentes stratégies d’autorégulation dans les différents scénarios et la régularité moyenne d’utilisation déclarée lors de l’entretien pour chaque stratégie. Les stratégies les plus souvent mentionnées par la deuxième participante sont trois, dont : « Répétition et mémorisation », « Organisation et transformation », « Fixation d’objectifs et planification ». En ce qui concerne la stratégie « Répétition et mémorisation », elle est mentionnée quatre fois dans deux scénarios différents. En moyenne, la participante utilise cette stratégie la plupart du temps, un résultat cohérent avec ce qui est affirmé dans les deux scénarios. De plus, il est curieux de constater que dans les deux scénarios, la participante utilise la réécriture, à la main ou à l’ordinateur, comme méthode de mémorisation et de répétition des informations. En ce qui concerne la stratégie «Organisation et transformation », la participante mentionne cette stratégie trois fois dans trois scénarios différents. En moyenne, elle utilise cette stratégie la plupart du temps, un résultat cohérent dans les scénarios un et quatre. Cependant, dans le scénario deux la participante déclare qu’elle utilise cette stratégie fréquemment. La stratégie « Fixation d’objectifs et planification », est mentionnée trois fois dans trois scénarios différents. En moyenne, la participante utilise cette stratégie fréquemment, un résultat qui est cohérent dans tous les scénarios. Il est également intéressant de noter que dans les scénarios cinq et six, la participante mentionne la même stratégie de planification.
En ce qui concerne les autres stratégies qui n’ont pas souvent mentionnées, la participante déclare qu’elle utilise occasionnellement la stratégie « Tenue de registres et suivi ». Ce résultat n’est pas cohérent avec ce que la participante déclare implicitement dans presque tous les scénarios. En fait, il semble qu’elle utilise toujours les notes prises en classe pour résumer et étudier. Cela signifie que pendant les cours, la participante enregistre toutes les informations importantes sous forme de notes. En outre, la participante déclare qu’elle demande fréquemment de l’aide à ses camarades de classe ou à les enseignant·e·s. Cependant, la stratégie « Recherche d’aide sociale » n’est mentionnée que dans un seul scénario.
2.5. Discussion sur l’outil de mesure
Le SRLIS s’est révélé être un outil utile pour identifier les stratégies d’apprentissage autorégulé des étudiant. En ce sens, l’entretien s’est avéré être une méthode très efficace pour étudier un ou plusieurs aspects importants et pour poser des questions supplémentaires aux participantes. Cependant, l’analyse et l’interprétation des résultats doivent être considérées avec prudence en raison de l’échantillon limité, qui ne permet pas de tirer des conclusions solides. En outre, plusieurs limites ont été rencontrées lors de l’entretien et de l’analyse des résultats.
Tout d’abord, la similitude entre les scénarios entraîné une confusion chez les participantes, les empêchant de répondre de manière claire. En fait, les participantes ont mentionné plusieurs fois les mêmes stratégies, ce qui a rendu l’interprétation moins variée et moins différenciée. Par conséquent, afin d’augmenter la validité de l’instrument, il est nécessaire de formuler des scénarios plus diversifiés qui permettent aux participant·e·s d’expliciter différentes stratégies d’autorégulation. En outre, le contenu du test présente d’autres problèmes de validité, car les six scénarios, en plus d’être trop similaires, ne sont pas représentatifs de la réalité universitaire. Il serait donc nécessaire de rendre les scénarios plus représentatifs et spécifiques de l’environnement universitaire en fournissant des exemples concrets ; par exemple, au lieu d’écrire « devoirs universitaires », il faudrait être plus explicite et parler de la rédaction du travail de bachelor, du master etc.
Une autre faiblesse de ce test concerne l’analyse des résultats, qui s’est souvent révélée imprécise et coûteuse en termes de temps. Tout d’abord, plusieurs stratégies mentionnées par les participantes ne correspondaient pas exactement aux catégories définies par Zimmerman et Martinez-Pons (1986). En effet, certaines stratégies pouvaient être classées dans plus d’une catégorie à la fois. De plus, le codage des données n’a été effectué que par une seule personne, ce qui a pu compromettre la fidélité des résultats. Pour assurer donc une plus grande fidélité, il serait nécessaire d’impliquer plusieurs évaluateurs afin de calculer un accord inter-juges et de vérifier la cohérence entre les jugements (Bandalos, 2018).
3. Thinking aloud
3.1. Description de l’outil
Le Thinking aloud est une méthode qualitative utilisée pour identifier les processus d’autorégulation des élèves pendant l’exécution d’une tâche. En ce sens, le Thinking aloud consiste à enregistrer les étudiant·e·s lorsqu’elles verbalisent à voix haute leurs pensées, leur raisonnement, leurs choix stratégiques et leurs émotions pendant l’exécution d’une tâche complexe (Hu et Gao, 2017).
3.2. Description de la méthodologie
Les participantes ont été invitées à verbaliser tous leurs raisonnements, pensées, stratégies et émotions lors de l’exécution d’une jeu complexe (cf. figure 1.). Au début, les participantes ont été informées de leur participation volontaire et de la possibilité de se retirer à tout moment sans aucune conséquence. La confidentialité de leurs réponses était également garantie.
Avant le début de la tâche, les participantes ont eu suffisamment de temps pour lire les règles et comprendre le jeu. Les participantes ont ensuite été enregistrées pendant qu’elles réfléchissaient à haute voix à la manière de terminer le jeu. Les réponses ont été enregistrées et sont présentées en annexe avec des représentations graphiques du raisonnement des participantes (cf. transcription 3 ; transcription 4 ; figures 2 et figure 3.).
Les réflexions des participantes seront analysées et interprétées selon les phases cycliques de l’autorégulation de Zimmerman (2002). Cette approche a permis d’identifier et de situer les raisonnements des participantes dans les différentes phases du processus d’autorégulation, divisées en trois couleurs principales : jaune, vert et bleu. Cette catégorisation a permis une interprétation détaillée du raisonnement des participantes (cf. tableau 5a et tableau 5b.).
3.3. Présentation des résultats
3.3.1 Interprétation des résultats de P1
En ce qui concerne les résultats de la première participante (cf. tableau 5a.), il a été possible d’observer des comportements relatifs à la phase d’anticipation. Au début, la participante définit et planifie sa stratégie, démontrant ainsi sa capacité à diriger sa cognition et les actions. Cependant, au cours du raisonnement, elle planifie rarement de nouvelles stratégies. Ces processus d’anticipation sont basés sur ses croyances auto-motivationnelles, qui apparaissent de manière limitée dans son raisonnement.
Les comportements de la phase d’action sont prédominants. Il y a de nombreux moments où la participante met en œuvre son approche stratégique, montrant sa capacité à s’auto-instruire ou à se faire des images mentales. En outre, il y a également de nombreux moments où la participante autorégule son apprentissage en monitorant ses pensées, ses actions et ses comportements, en modifiant sa stratégie si nécessaire (« Et pour éviter d’entrer dans la zone de rayon du pion en 6D, je… Non, je ne le fais pas, parce que comme ça […] »). Cependant, plusieurs difficultés à enregistrer les mouvements et actions précédents apparaissent (« […] Je ne sais pas d’où je suis parti […] Mais je n’arrive pas à m’en souvenir […] »).
Les comportements liés à la phase d’autoréflexion ne sont pas fréquents. Il y a peu de moments où la participante évalue son apprentissage (« Et puis… je vois que j’ai fait une erreur […]. ») et cherche à comprendre les causes de ses erreurs (« C’est donc impossible. A moins que les règles que j’ai choisies au départ ne soient erronées. Et je n’ai pas compris. »). En outre, la participante réagit peu à son apprentissage. Bien qu’elle tente de tirer des conclusions constructives sur l’inefficacité de la stratégie utilisée, ces réflexions ne semblent pas efficaces. Ceci est probablement dû à la confusion générée par l’absence d’un auto-enregistrement clair de l’information pendant la phase d’action. En conséquence, la participante a recours à une inférence défensive, car elle choisit de continuer à utiliser la même stratégie tout en sachant qu’elle est erronée (« Alors, je ne sais pas comment j’y suis arrivé. Mais de toute façon, je continue […] »). La participante montre ainsi des difficultés à déclencher un nouveau cycle d’autorégulation et à planifier des stratégies plus efficaces.
3.3.2 Interprétation des résultats de P2
En ce qui concerne les résultats de la deuxième participante (cf. tableau 5b.), il est possible d’observer des comportements relatifs à la phase d’anticipation. La participante analyse la tâche, définit des objectifs et planifie une stratégie pour guider sa cognition et ses mouvements. Ces comportements sont réalisés de manière modérée, car elle planifie fréquemment de nouvelles stratégies au cours de son raisonnement. Ces processus d’anticipation sont basés sur ses croyances auto-motivationnelles, qui apparaissent de manière modérée dans son raisonnement.
Les comportements de la phase d’action sont prédominants. Il y a de nombreux moments où la participante met en œuvre son approche stratégique, montrant sa capacité à s’auto-instruire ou à se faire des images mentales. Il y a également de nombreux moments où la participante autorégule son apprentissage en contrôlant ses actions et ses stratégies, en apportant des changements si nécessaire (« Puis je remonte en E4, pour la même raison, parce que je suis, ah non, je suis sur la mauvaise ligne […] »).
Les comportements liés à la phase d’autoréflexion sont présents à un degré modéré. La participante évalue son propre apprentissage (« C’est un choix difficile à faire. Je vais y réfléchir quelques secondes […] ») et attribue ses erreurs à des causes spécifiques (« Je n’arrive pas à comprendre la stratégie, la règle […] »). Par la suite, la participante réagit à son apprentissage, montrant d’abord son insatisfaction à l’égard de ses stratégies (« En fait, je me sens vraiment, vraiment beaucoup confuse, parce que je n’arrive pas à comprendre où sont les rayons […] »), puis tirant des conclusions constructives sur ses propres stratégies et leur inefficacité (« […] Je pense que j’ai fait une petite erreur […]. Je vais donc recommencer. Et cette fois, je vais mettre mon pion sur la case numéro […] »), réussissant ainsi à déclencher un nouveau cycle d’autorégulation.
3.4. Discussion sur l’outil de mesure
Le Thinking aloud s’est avérée être un outil utile pour identifier les différentes phases du processus d’autorégulation des étudiant·e·s. En fait, le Thinking aloud a montré que les apprenant·e·s adoptent une approche cyclique de l’apprentissage, en s’engageant dans des activités de préparation, d’exécution et d’évaluation. Toutefois, l’analyse et l’interprétation des résultats doivent être considérées avec prudence en raison de l’échantillon limité, qui ne permet pas de tirer des conclusions solides. En outre, plusieurs limites sont apparues au cours de la phase d’exécution et de l’analyse des résultats.
Immédiatement après avoir lu les règles du jeu, les participantes ont demandé des explications supplémentaires parce qu’elles ne comprenaient pas totalement le fonctionnement du jeu. Même pendant l’exécution de la tâche, les deux participantes ont exprimé leur confusion quant aux règles du jeu, déclarant à plusieurs reprises que les règles étaient incomplètes et peu claires. Ce manque de compréhension a pu conduire à une verbalisation incomplète de la part des participantes, ce qui a significativement affecté la validité de l’analyse. En outre, pendant l’exécution de la tâche, les participantes oubliaient souvent d’expliciter leur raisonnement et il était donc nécessaire de leur rappeler constamment de faire état de leurs pensées en posant des questions stimulantes. Dans ce sens, selon Hu et Gao (2017) tous les étudiant·e·s ne sont pas habitué·e·s à exprimer leurs pensées à voix haute, il est donc nécessaire d’organiser des sessions de formation et de familiarisation avec des tâches et des activités similaires avant la tâche officielle.
L’interprétation avec le processus cyclique de Zimmerman (2002) s’est avérée assez complexe. En fait, comme l’expliquent Vandevelde et al. (2015) en raison de la grande quantité d’informations fournies par le Thinking aloud, il est difficile d’interpréter avec précision le raisonnement des apprenant·e·s. En ce sens, il était difficile d’identifier précisément, à partir du raisonnement, dans quelle phase du processus cyclique d’autorégulation les participantes se trouvaient. En outre, certains aspects internes plus inconscients des apprenant·e·s, tels que les aspects motivationnels, l’auto-efficacité personnelle, etc. étaient particulièrement difficiles à détecter avec le Thinking aloud. Il serait donc nécessaire de combiner l’utilisation de le Thinking aloud avec d’autres mesures telles que les questionnaires sur la motivation ou l’auto-efficacité.
4. Comparaison entre SRLIS et Thinking aloud
Bien que les deux instruments diffèrent en termes de méthodologie et d’approche, ils permettent tous deux d’évaluer l’apprentissage autorégulé des étudiant·e·s. Le SRLIS, sous la forme d’un entretien directif, permet une analyse approfondie des stratégies autorégulées des élèves. D’autre part, le Thinking aloud permet d’observer en temps réel toutes les phases de l’apprentissage autorégulé des élèves pendant qu’ils effectuent une tâche complexe. Par conséquent, leur combinaison peut offrir une perspective plus riche et une analyse plus complète et plus approfondie de l’apprentissage autorégulé. En ce sens, l’analyse comparative a révélé diverses cohérences et incohérences entre les données des participantes (cf. figures 4 et 5.).
Par exemple, les résultats du Thinking aloud montrent que P1 a fait un usage important de la phase d’action, en contrôlant et en modifiant fréquemment ses stratégies. Ce résultat est cohérent avec les résultats du SRLIS, car les stratégies qui peuvent être associées à la phase d’action sont fréquemment mentionnées ; en fait, dans l’ensemble, elles ont une fréquence d’utilisation élevée. Pour P2, les résultats du Thinking aloud montrent une utilisation modérée de la phase d’autoréflexion ; en effet, la participante évalue et réagit modérément à son apprentissage. Cependant, ce résultat n’est pas cohérent avec les résultats du SRLIS, car la participante ne mentionne l’utilisation de la stratégie d’auto-évaluation dans aucun scénario.
Les différentes incohérences soulignent la nécessité de reconsidérer et d’optimiser la manière dont les deux instruments sont combinés afin d’obtenir une analyse plus précise et plus complète de l’apprentissage autorégulé des étudiant·e·s.
5. Conclusion
Le SRLIS et le Thinking aloud semblent être des outils utiles pour mettre en évidence les stratégies et les processus d’autorégulation des etudiant·e·s, car ils permettent de comprendre comment ces processus se manifestent et varient d’un élève à l’autre. Cependant, les différentes limites qui sont apparues soulignent la nécessité d’améliorer la précision et la validité de l’analyse. En ce sens, les scénarios proposés dans le SRLIS devraient être modifiés afin d’obtenir une analyse plus différenciée et plus fiable. D’autre part, on pourrait envisager de combiner le Thinking Aloud avec d’autres outils, tels que des questionnaires ou des mesures directes, afin d’enrichir et d’affiner l’analyse des processus d’autorégulation des apprenant·e·s.
De plus, même si les deux instruments adoptent des approches et des méthodes différentes, leur combinaison pourrait s’avérer avantageuse pour une évaluation plus complète des stratégies et des processus d’autorégulation des élèves. Cependant, les nombreuses incohérences qui sont apparues soulèvent des questions sur la manière dont les deux instruments peuvent être combinés.
Par conséquent, les limites et les incohérences soulèvent des questions quant aux actions à entreprendre pour accroître la validité et la fidélité des outils. La mise à jour continue, basée sur les avancées scientifiques et le retour d’information, peut être une bonne stratégie pour optimiser l’utilisation de SRLIS et de Thinking Aloud dans l’étude de l’apprentissage autorégulé.
6. Bibliographie
- Bandalos, D. L. (2018). Measurement theory and applications for the social sciences. The Guilford Press.
- Berger, J.-L., et Buchel, F. (2013). Le concept d’apprentissage autorégulé : Une introduction. In J.-L. Berger et F. Buchel (dir.), L’autorégulation de l’apprentissage : Perspectives théoriques et applications (p. 17–30). Les Éditions Ovadia.
- Boekaerts, M. (1997). Self-regulated learning: A new concept embraced by researchers, policy makers, educators, teachers, and students. Learning and Instruction, 7(2), 161-186. https://doi.org/10.1016/S0959-4752(96)00015-1
- Frenkel, S. (2014). Composantes métacognitives ; définitions et outils d’évaluation : Enfance, 4(4), 427–457. https://doi.org/10.3917/enf1.144.0427
- Hu, J., et Gao, X. (2017). Using think-aloud protocol in self-regulated reading research. Educational Research Review, 22, 181-193. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.09.004
- Schunk, D. H., et Greene, J. A. (2017). Historical, Contemporary, and Future Perspectives on Self-Regulated Learning and Performance. In D. H. Schunk et J. A. Greene (dir.), Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance (2e éd., p. 1-15). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315697048-1
- Vandevelde, S., Van Keer, H., Schellings, G., et Van Hout-Wolters, B. (2015). Using think- aloud protocol analysis to gain in-depth insights into upper primary school children’s self-regulated learning. Learning and Individual Differences, 43, 11-30. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2015.08.027
- Zimmerman, B. J. (1990). Self-Regulated Learning and Academic Achievement: An Overview. Educational Psychologist, 25(1), 3-17. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2501_2
- Zimmerman, B. J. (2002). Efficacité perçue et autorégulation des apprentissages durant les études: Une vision cyclique. La formation autodirigée. Aspects psychologiques et pédagogiques, 69-88.
- Zimmerman, B. J., et Martinez-Pons, M. (1986). Development of a Structured Interview for Assessing Student Use of Self-Regulated Learning Strategies. American Educational Research Journal, 23(4), 614-628. https://doi.org/10.3102/00028312023004614